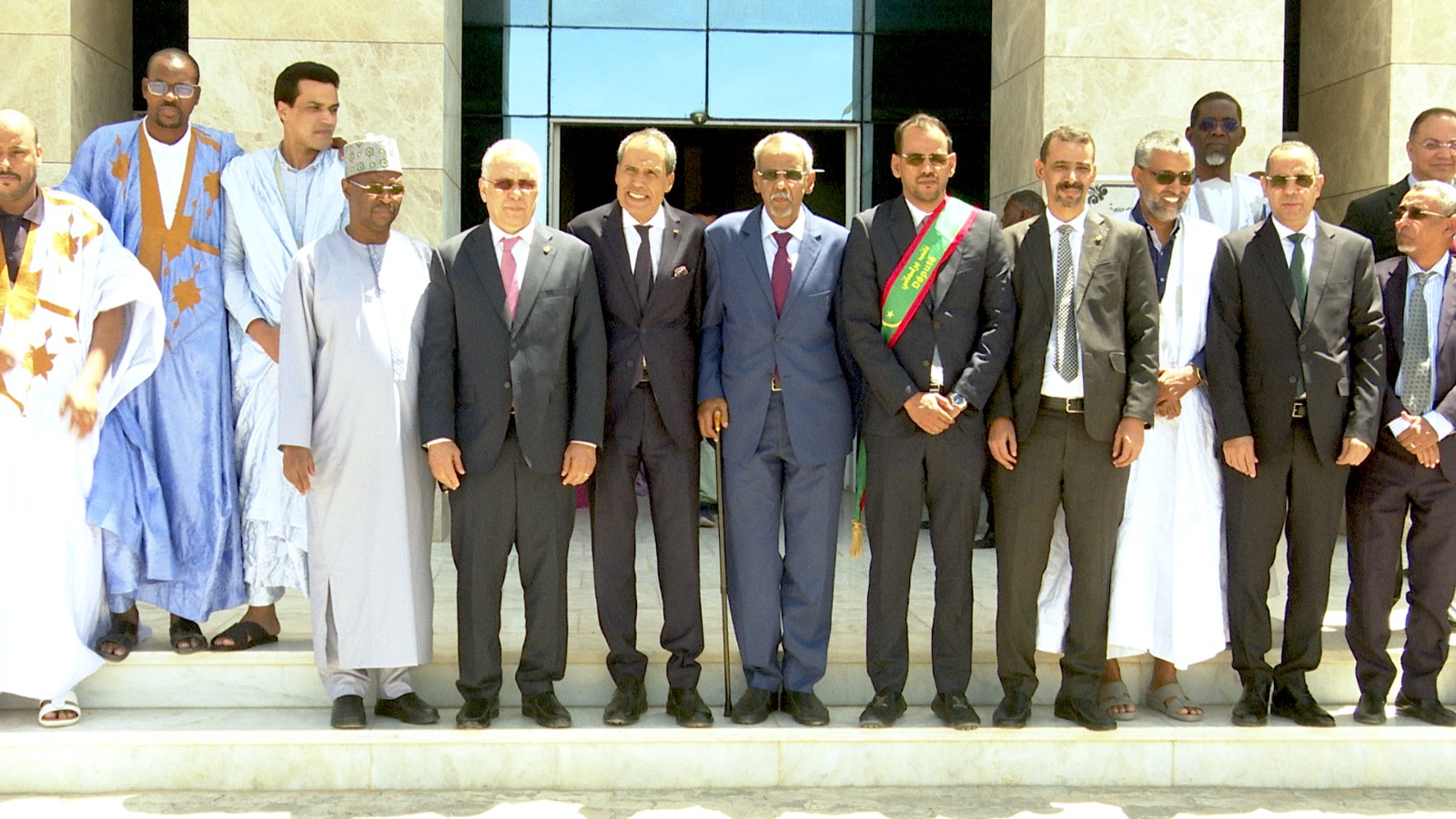A quoi sert l’assemblée nationale ? Cette question à première vue provocatrice est pourtant récurrente dans la bouche du citoyen lambda qui a souvent une mauvaise image des élus qu’il a pourtant paradoxalement contribué à élire.
A l’occasion de la présentation récente à l’Assemblée nationale des projets de loi sur la Déclaration du patrimoine et la lutte contre la corruption approuvés en début d’année en conseil des ministres, l’absence des députés dans la liste des personnalités devant déclarer leur patrimoine a soulevé un véritable tollé.
En effet, dans son article 4, il est fait obligation de déclaration de patrimoine des personnalités suivantes :du Président de la République, des parlementaires, du président et des membres du Conseil constitutionnel, du Premier Ministre et des membres du Gouvernement et assimilés, du président de la Cour des comptes, du Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, des ambassadeurs et consuls et des walis.
Mais le hic dans cette nouvelle loi anti-corruption c’est l’omission effectuée au niveau du parlement par les députés de leur corporation. Ainsi les députés ne font pas de déclaration de patrimoine, ce qui en soit est anormal car parmi eux il y a des hommes d’affaires. Pourquoi alors les exclure ?
Pourtant l’inclusion des députés dans cette liste est plus qu’évidente. De ce fait, leur exclusion constitue une violation flagrante des engagements internationaux de la Mauritanie, note un spécialiste.
Dispositif de contrôle et stratégie anti-corruption
La nouvelle loi anti-corruption est très coercitive. Les auteurs de détournements des deniers publics n’ont plus droit à des circonstances atténuantes. Il ne suffit plus seulement de rembourser mais le dossier est directement transmis par l’IGE ou la Cour des Comptes au Parquet qui détient seul le pouvoir d’appréciation.
Cette loi renforce le contrôle, dont l’objectif est d’imposer le respect des lois et règlements relatifs à la gestion des biens publics.
Il y a différents types de contrôle : parlementaire, juridictionnel, administratif, Conseils d’administration, Inspections départementales…ainsi que les concepts de contrôle comme l’audit, l’inspection, l’évaluation…
En vertu des procédures de contrôle, les ministres exercent soit directement soit par l’intermédiaire des corps de contrôle, le contrôle des opérations des dépenses.
Le travail de contrôle est préventif et la loi est de plus en plus coercitive.
Nécessité de sévir contre les pratiques de corruption en Mauritanie
A l’heure où le gouvernement vient de mobiliser plus de 300 milliards d’ouguiyas afin de booster le développement du pays, les institutions de contrôle doivent être en état d’alerte maximale.
En Mauritanie la corruption est solidement ancrée dans les pratiques et dans le mode de gestion et ce malgré la mise en œuvre de programmes d’appui à la bonne gouvernance et d’institutions de régulation et de contrôle, le rôle croissant de la société civile et l’adhésion du pays à plusieurs conventions internationales.
En effet le pays est signataire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, et en 2010 un projet de loi relatif à la lutte contre la corruption a été promulgué. C’est la fameuse loi n°2016.014 qui a été adoptée par le parlement.
Et dans son article 1, c’est une loi « visant à prévenir et combattre la corruption dans toutes ses formes » mais aussi faciliter et appuyer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la corruption et le recouvrement des avoirs qui y sont relatifs ; promouvoir l’intégrité et la transparence dans la gestion des secteurs public et privé et l’effectivité du principe de la responsabilité et la gestion saine des biens publics.
Ces objectifs sont remplis à travers les huit chapitres qui constituent ce projet de loi. Le Chapitre premier est relatif aux dispositions générales. Le chapitre deuxième est consacré aux mesures préventives de la corruption. Le chapitre troisième met en place l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Le chapitre quatrième contient les incriminations et les sanctions en matière de corruption. Le Chapitre cinquième détermine les procédures judiciaires applicables en matière de poursuites des infractions liées à la corruption. Le chapitre sixième est dédié aux instances judiciaires compétentes et le chapitre septième à la coopération internationale et le recouvrement d’avoirs liés à la corruption. Le chapitre huitième est réservé aux dispositions finales qui facilitent l’application de ce texte fondamental en matière de lutte contre la corruption.
Ce projet de loi introduit les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption dans l’arsenal juridique mauritanien.
Ladite loi réglemente tous les aspects de la vie publique y compris la gestion des ressources humaines. C’est ainsi que dans son article 3 elle stipule que : « Dans le système de recrutement des fonctionnaires du secteur public et pour la gestion de leurs carrières, il est tenu compte des règles suivantes: les principes d’efficacité et de transparence et les critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude ; les procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption ; outre un traitement adéquat, des indemnités suffisantes ; l’élaboration de programmes d’éducation et de formation adéquats de manière à permettre aux agents publics de s’acquitter de leurs fonctions d’une manière correcte, honorable et adéquate et de les faire bénéficier d’une formation spécialisée qui les sensibilise d’avantage aux risques de corruption. »
Et comme on a déjà eu à le souligner la loi dans son article 4, fait obligation de déclaration de patrimoine pour les personnalités les plus en vue.
« La personne concernée souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit sa date d’installation ou celle de l’exercice de son mandat électif.
En cas de modification substantielle de son patrimoine, la personne concernée procède immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellement de la déclaration initiale.
La déclaration de patrimoine est également établie tous les deux ans et en fin de mandat ou de cessation d’activité. »
La loi codifie l’information sur le conflit d’intérêt, la passation des marchés publics, la gestion des finances publiques, la transparence dans les relations avec le public, les mesures concernant le corps des magistrats, le secteur privé, les normes comptables, la participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption est encouragée.
Il y a aussi les mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent…
La loi prévoit également la création de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
Notons qu’il y a eu également l’adoption d’une loi d’orientation portant sur la lutte contre la corruption. Dans son Article 2 on note : « La présente loi, qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption adoptée le 09 décembre 2010, traduit la volonté des Pouvoirs Publics à ériger la lutte contre la corruption en priorité de l’action du gouvernement. A travers des mesures transversales et sectorielles, cette loi vise notamment à :renforcer la prévention et la lutte contre la corruption; promouvoir l’intégrité, la responsabilité, la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des secteurs public et privé et dans la société civile ; faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d’avoirs détournés. »
Dans l’Article 5 de cette loi d’orientation, on peut lire que : « L’État veille au recouvrement des biens et avoirs détournés ou acquis illicitement et à la rupture avec l’impunité par :la mise en place des mécanismes fonctionnels de suivi des dossiers en rapport avec la corruption et les infractions connexes transmises aux instances judiciaires ; la mise en place des mécanismes de gel, de saisie conservatoire et de recouvrement des avoirs et biens produits de la corruption ; le renforcement de la coopération internationale en matière de récupération des avoirs.
Et l’Article 6 préconise que : « L’État doit procéder au renforcement du partenariat avec la société civile et le secteur privé dans la lutte contre la corruption par : le renforcement des capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles de la société civile dans l’optique de la rendre plus apte à jouer son rôle de contre-pouvoir intègre et honnête, et mener à bien sa mission de veille citoyenne et de dénonciation des actes et pratiques de corruption d’où qu’ils viennent ; l’établissement d’un partenariat avec le secteur privé en vue de décourager les pratiques de corruption dans ce secteur ; la mobilisation et l’engagement des syndicats de travailleurs dans la promotion de l’éthique et dans la lutte contre la corruption. »
Il y a lieu de souligner que tous les textes susmentionnés ont été mis à contribution par la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption qui confère à la Société Civile la possibilité de s’exprimer, de formuler des avis et d’engager des actions auprès des autorités et de la justice.
Dans le cadre des principes et axes de cette stratégie il est prévu d’identifier et traiter les secteurs les plus touchés par la corruption : Pour mener une action de prévention efficace, il s’agit dans l’immédiat, de concentrer l’action sur les secteurs, au sein de l’administration publique et de l’économie nationale, réputés particulièrement vulnérables à la corruption. A ce titre, et conformément aux résultats des études et enquêtes effectuées, une attention particulière doit être accordée à l’éducation, la santé, l’immobilier, la gestion des ressources naturelles, l’attribution des marchés publics, l’administration fiscale, les douanes, la police et les services judiciaires. Des codes de déontologie professionnelle devraient être établis, largement diffusés et rigoureusement appliqués.
Rupture avec l’impunité
Dans la rubrique « Sanction » de cette stratégie, il est envisagé de « restaurer la primauté du droit et rompre avec l’impunité : La rupture avec l’impunité constitue une mesure prioritaire, qui conditionne la crédibilité même de la stratégie. Dans ce cadre, une tolérance zéro s’impose à l’égard de tout acte de corruption avéré. Cet engagement solennel sera appliqué avec toute la fermeté nécessaire, afin de dissuader toute tentation de corruption ou de mauvaise gestion. L’objectif est de restaurer l’Etat de Droit et de réaffirmer l’autorité et l’indépendance des institutions face aux groupes d’influence. Dans ce cadre, la neutralité politique des poursuites sera assurée et les droits de la défense protégés, conformément aux lois en vigueur. »
Autre mesure brandie par la stratégie : « Appliquer systématiquement les sanctions prévues : Des sanctions efficaces seront appliquées à l’encontre de ceux qui nuisent à l’intérêt général à des fins d’enrichissement personnel. Les sommes indument acquises devront être restituées, majorées d’amendes. La responsabilité pénale et administrative des personnes morales sera appliquée et l’exclusion sera la règle pour les entreprises convaincues d’irrégularités au cours des procédures de passation de marchés. Les mesures de détection des délits de corruption seront renforcées, y compris en levant toute équivoque concernant le secret bancaire au cours des contrôles et des investigations pénales et fiscales. »
Il est aussi prévu de mettre en place un parquet anti-corruption : Il sera créé auprès du parquet de Nouakchott (avec des relais dans les cours d’appel) un pôle financier pour les investigations relatives à la corruption et aux délits économiques. Des chambres spécialisées pour ces délits seront établies au sein des Cours d’Appel et de la Cour Suprême.
Par ailleurs, l’obligation pour les hauts fonctionnaires, prévue par la loi du 18 septembre 2007, de faire une déclaration publique de patrimoine sera strictement appliquée et sa violation sanctionnée.
Et, au niveau du Parlement, le contrôle de l’exécution budgétaire sera étayé par des rapports soumis tous les six mois par le Gouvernement. Les ressources allouées aux commissions parlementaires permanentes seront augmentées et un rapport annuel de suivi de la stratégie anti-corruption sera soumis au Parlement, en marge de la session budgétaire.
Malheureusement la mise en œuvre de cette stratégie ambitieuse risque d’être freinée par des comportements similaires à ceux des parlementaires toujours plus enclins à faire passer des décisions d’intérêts personnels (augmentation de salaires et autres indemnités, distribution régulières de terrains à haute valeur ajoutée…) qu’à voter des lois d’intérêt général.
Ainsi, la non déclaration de leurs biens à l’instar des autres hauts fonctionnaires de l’Etat, bat en brèche la volonté politique du gouvernement de lutter contre la corruption et aura sans nul doute des conséquences négatives sur la lutte contre ce fléau ravageur, qui annihile toutes les velléités de développement du pays.
Bakari Guèye
![]()