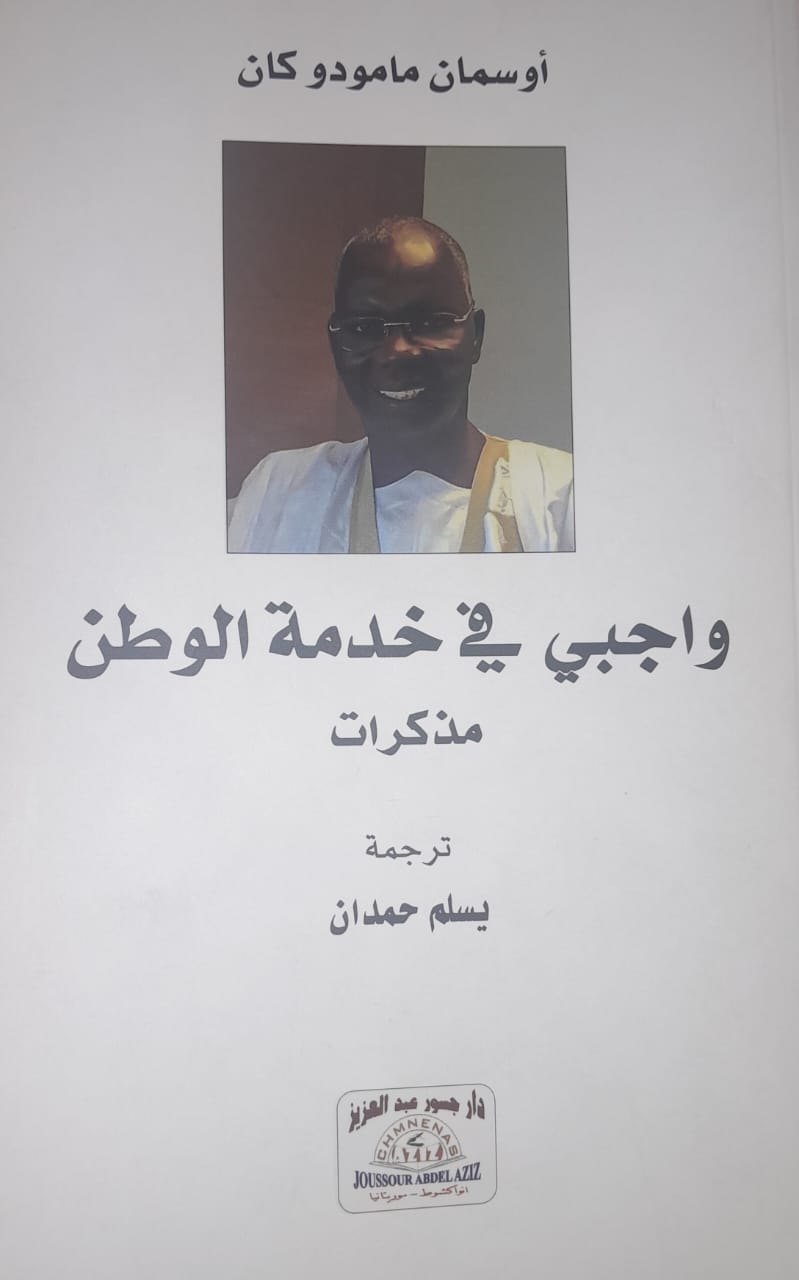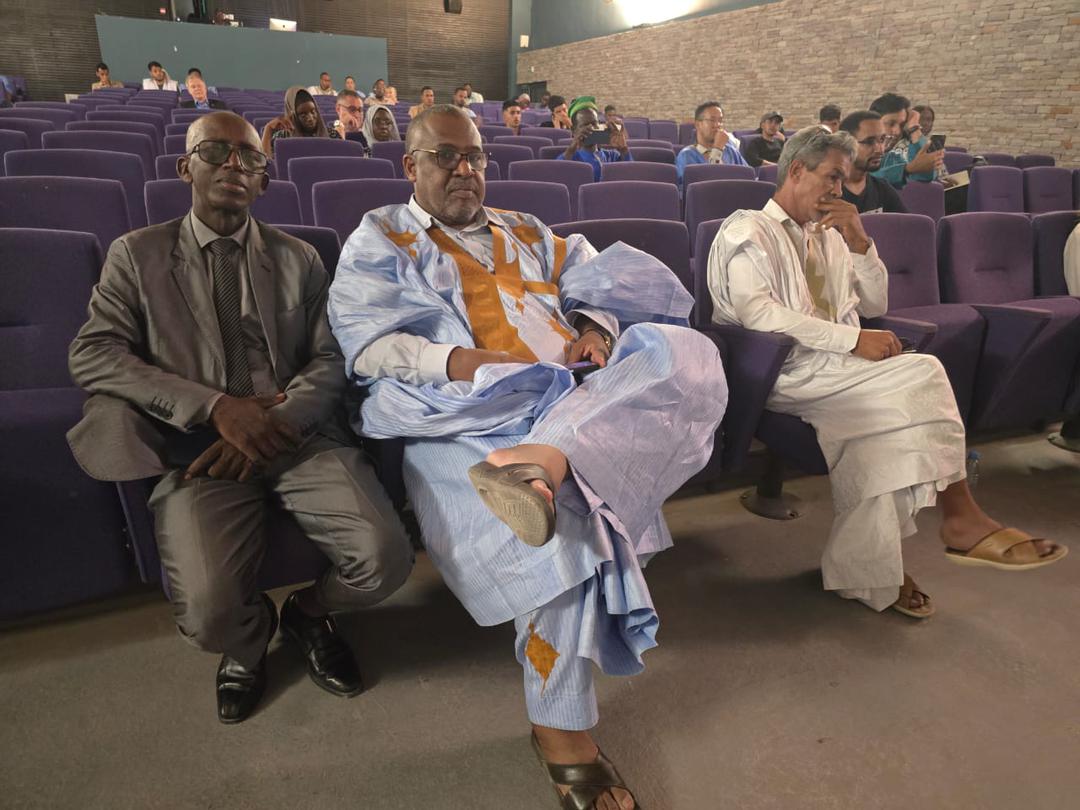Par Bakary Séta Wagué
Le peuple soninké, historiquement lié à l’Empire du Ghana, détient un patrimoine culturel et politique d’une richesse incontestable. Cet empire, structuré et prospère, constitue une référence majeure dans l’histoire ouest-africaine. Cependant, l’invocation répétée de ce passé glorieux semble aujourd’hui insuffisante face aux enjeux sociaux, économiques et politiques contemporains auxquels ce groupe est confronté.
Dans les pays où les Soninké sont présents – notamment en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, en Gambie et en Guinée – les défis rencontrés sont multiples : marginalisation politique, précarité économique, inégalités sociales, désagrégation des solidarités traditionnelles et perte progressive des repères culturels. Ces phénomènes reflètent une tension entre un passé valorisé et un présent en quête de repères stables.

Malgré ce contexte, le peuple soninké dispose de ressources importantes, tant sur le plan humain que culturel. Ces ressources pourraient constituer les bases d’un renouveau collectif, à condition qu’elles soient mobilisées dans une perspective tournée vers l’action et le changement social. Cela impliquerait un dépassement des divisions internes, des logiques d’inaction ou des formes de nostalgie qui freinent les dynamiques d’adaptation et de transformation.
L’histoire, si elle constitue une force symbolique, ne peut suffire à elle seule pour répondre aux exigences actuelles. Une reconfiguration des rapports sociaux, une revitalisation des formes de mobilisation communautaire et un engagement politique structuré apparaissent comme des leviers essentiels pour faire face aux enjeux contemporains. Il s’agit ainsi de substituer à une mémoire célébrée une mémoire agissante, susceptible de soutenir des actions concrètes en faveur de l’éducation, de la justice sociale, de l’unité culturelle et du développement.
La question posée n’est donc pas celle de la légitimité d’un héritage, mais de sa capacité à nourrir une dynamique collective cohérente. Le peuple soninké, en tant que nation culturelle transnationale, possède le potentiel de devenir un acteur majeur dans les processus de transformation sociale à l’échelle régionale. La redéfinition de son rôle historique passe par une articulation entre mémoire, action et responsabilité.
![]()